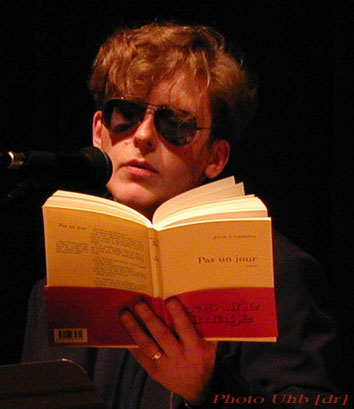
4ème de couverture
Que faire de ses penchants ?
T’assignant cinq heures par jour, un mois durant, à ton ordinateur, tu te donnes pour objet de raconter le souvenir que tu as d’une femme ou autre que tu as désirée ou qui t’a désirée.
Tu les prendras dans l’ordre où elles te reviendront en mémoire. Tu les coucheras ensuite dans l’ordre impersonnel de l’alphabet.
Mais pourquoi cet exercice d’une ironie peut-être cruelle ?
Dissiper ou digresser tes désirs.
Car la vie est trop courte pour se résigner à lire des livres mal écrits et coucher avec des femmes qu’on n’aime pas.
Affaire de style.
Ne risques-tu pas, entendant pourtant t’écarter des moeurs de ton temps et esquiver son idolâtrie du désir, d’y succomber ?
Peut-on échapper à la publicité du désir ?
Et si, croyant résister à son assujettissement, tu ne faisais que pratiquer cette forme —si française— de résistance qui s’appelle la collaboration.
Ante Scriptum
Que faire de ses penchants ?
Il s’agirait d’écrire autre chose, autrement que tu ne fais d’habitude. Une fois encore, mais par un autre tour, te déprendre de toi-même. Te déprendre des formes que revêt cette déprise et tenter de différer un peu plus encore de ce que tu crois être. Si tu ne conçois plus écrire autrement que par longues et méditées constructions, n’est-il pas temps d’aller à l’encontre ?
Le roman prochain que tu entrevois et dont tu rumines les calculs, te prendra des années à rechercher, composer, écrire. Tu as pitié de tes quelques lecteurs et te soucies de ne pas outrepasser toujours leur patience et bonne volonté. Tu leur voudrais offrir entre temps ce que tu les soupçonnes désirer : un divertissement, l’illusion d’un dévoilement de ce qu’ils s’imaginent un sujet. Car ils te supposent — faiblesse commune et jusqu’à encore peut-être quelque temps de l’avenir, inéluctable — un moi.
Comme tu n’as pas le coeur de leur dire (d’ailleurs, ils refuseraient de te croire, car cela est une effrayante nouvelle tant que nous n’aurons pas fini de cuver l’ivre-mort de notre petit moi) que nul sujet ne s’exprime jamais dans nulle narration, tu as résolu de feindre au moins d’emprunter la pente que l’on croit de nos jours naturelle, et te contraindre délibérément au genre de l’écriture qu’on disait autrefois intime. Raconter sa vie, on ne fait plus que cela semble-t-il aujourd’hui, et encore, sous l’angle censé depuis plus d’un siècle lui donner sens, en être la clef universelle. Bref, le passe-partout de la subjectivité: le désir.
Et tu pourras dire comme — et contre — Rousseau, celui-là même qui a inauguré ou achevé notre corruption : “Il faut des spectacles dans les métropoles de l’ère post-moderne, et des confessions aux peuples idolâtres. J’ai vu les moeurs de mon temps et j’ai publié ces récits. Que n’ai-je vécu dans un siècle où je dusse les jeter au feu.”
Cette ironie te réjouit avant même d’avoir écrit une ligne. Tu joueras à ce très vieux jeu devenu la marotte de la modernité qui renâcle à se désenchanter pour de bon : la confession, ou comment racler les fonds de miroirs.
Un jour de septembre 1835, dans une allée près du lac Albano, Stendhal ou Henri Beyle ou Henri Brulard — on ne sait lequel… peut-être tous à la fois — trace dans le sable les initiales des femmes qu’il a aimées : V, An, Ad, M, Mi, Al, Aine, Apg, Mde, C, G, Aur et enfin Mme Azur. De cette dernière, le prénom lui échappe. Liste de Don Juan malheureux : “Dans le fait, je n’ai eu que six de ces femmes que j’ai aimées.”
H. B. te présente là l’esquisse d’un projet, mélancolique et d’une ironie cruelle, qui conviendrait bien à ta convalescence : l’alphabet bégayant du désir.
Quitte à contrarier tes habitudes et tes penchants, autant systématiquement le faire. Voici l’ascèse que tu as pour toi réglée (on ne peut plus radicalement différer ni dissembler de soi-même que tu entreprends ici de le faire). Elle tient en une maxime : pas un jour sans une femme.
Ce qui veut dire simplement que tu t’assigneras cinq heures (le temps qu’il faut à un sujet moyennement entraîné pour composer une dissertation scolaire) chaque jour, un mois durant, à ton ordinateur, te donnant pour objet de raconter le souvenir que tu as d’une femme ou autre que tu as désirée ou qui t’a désirée. Le récit ne sera que cela, le dévidage de la mémoire dans le cadre strict d’un moment déterminé.
Tu écriras comme on va au bureau ; tu seras fonctionnaire de la mémoire de tes désirs, trente-cinq heures par semaine. Ni plus ni moins que cinq heures par initiale.
Tu les prendras dans l’ordre où elles te reviendront à l’esprit. Tu les coucheras ensuite dans l’ordre impersonnel de l’alphabet. Au diable la chronologie.
Tu t’interdis d’utiliser tes instruments habituels : pas de stylo, rien que le clavier (ne s’agit-il pas de recorder ?). Pas de brouillon, pas de notes recueillies dans un cahier, pas d’architecture réfléchie et composée, nulle autre règle que celles, purement matérielles et logistiques, que tu donnes à l’acte.
Nul autre principe que d’écrire de mémoire. Ne visant pas à dire les choses telles qu’elles eurent lieu, non plus qu’à les reconstruire telles qu’elles auraient pu être, ou telles qu’il te paraîtrait beau qu’elles eussent été, mais telles qu’au moment où tu les rappelles elles t’apparaissent.
Au fil du clavier, tu décimeras purement tes souvenirs. Et qu’importe si, au terme de tes cinq heures de remémoration, rien n’aura été consommé. S’agit-il de savoir si on a eu les femmes qu’on a désirées …? L’écriture au risque de la mémoire est méandre et incertitude comme le désir, jamais assuré de sa fin ni de son objet.
Ni rature, ni reprise, ni biffure. Les phrases comme elles viendront, sans les comploter. Et interrompues sitôt que suspendues. La syntaxe à l’avenant de la composition…
Enfin peut-être parviendras-tu, dans la faible mesure de tes moyens, à émuler tes contemporains, racontant leur vie, pissant de la copie de vécu — et s’y croyant.
Tu aurais pu faire mieux et tenir un journal. Mais tu n’as pas le talent de tes contemporains. Au jour le jour, tu n’aurais rien eu à rapporter : il ne t’arrive jamais rien qu’en mémoire. Tu ne saisis l’instant que dans le souvenir lointain, qu’après que l’oubli a donné aux choses, aux êtres, aux événements la densité qu’au jour, évanescents, ils n’ont jamais. Tes jours sont de vapeur, de buée imperceptible. Le monde (et toi de même) est fantôme que seul le temps, la nuit du temps rend visible et dans le même instant efface. En plein jour, ils ne portent pas même d’ombre. Sensibilité de plaque photographique, qui ne se révèle que lentement. Et qui, il te semble, ne connaît pas de fixateur : ramenée à la lumière de l’écran, de la page et tenue trop longtemps sous le regard, la mémoire se dissout sans rémission. Il n’en reste que l’image de l’image, le cliché pris à l’occasion de la remémoration. De copie en copie du souvenir, il pâlit, bouge. N’en demeure bientôt que la caricature — et les détails seuls que le regard, s’appesantissant, a grossis.
Tu te concentreras et te dissiperas ainsi d’un même mouvement. Tu te dissiperas en pensée, tu t’adonneras à un libertinage mental à heures fixes, et purement discursif, toi qui depuis une éternité as renoncé au libertinage, et devenue d’une simplicité de moeurs que tes contemporains ne sauraient croire. Et que tu n’eusses certes jamais pu imaginer lorsque tu te croyais contemporaine de toi-même.
Tu te dissiperas en pensée, et pour te divertir des désirs que tu pourrais encore éprouver, que tu risques toujours d’éprouver quand bien même tu as appris à en déjouer les ruses les plus triviales.
Disons que c’est un beau soir d’été, qu’après trois mois passés allongée sur ton divan à attendre que se consolide la grosse fracture qui t’a laissé dans la jambe droite deux plaques de métal, treize vis et le loisir d’analyser les nuances subtiles de la douleur physique, le goût de la morphine grenadine, de t’émerveiller de la chance que tu as eue, tout bien considéré, de te sortir à si bon compte d’un accident absurde, car lorsque tu en as développé le souvenir, tu as enfin vu qu’il aurait pu te coûter ta vie ou ton corps, le divisant au gré d’une paralysie plus ou moins grave, qu’après donc trois mois et un renouvellement de bail avec la vie, avec le mouvement, c’est un bien beau soir d’été, un soir où le corps enfin libre de trop de douleur, retrouve dans le désordre tous ses appétits, celui de la danse, celui des autres corps, celui des femmes. Il suffirait d’aller s’asseoir à la terrasse d’un café, regarder les passantes. Le désir sûrement dévalerait sa pente, naturellement assez abrupte, et avant même de le savoir sans doute te serais-tu créé des souvenirs de plus.
Il en est du désir comme de la douleur — tu l’as appris de ton accident. C’est la surprise qui les rend incontrôlables. Se réveiller de leur absence brutalement, ils emportent tout. Les tenir en lisse demande sang-froid, attention et régularité.
Dissiper, esquiver ou digresser tes désirs, telle est la finalité de cette petite expérience que tu tentes et dont tu espères qu’elle suffira à te mener jusqu’au moment de monter dans l’avion qui te transportera outre-Atlantique sur l’autre bord du désir. Ou pour le dire autrement, toi qui fus longtemps frivole, d’une frivolité que sans doute les récits que tu entends dévider chaque jour de ce mois de juillet 2000 risquent d’illustrer assez, toi donc qui fus longtemps frivole, et dont la pente naturelle (c’est-à-dire certainement humaine, et aggravée de toute la surestimation française de cet art d’être volage qui confond la grâce et la légèreté, les plaisirs de chair et ceux de vanité) est loin d’être aplanie, t’es délibérée depuis certain temps déjà de ne plus vivre dans la sujétion de désirs désordonnés.
Car la vie est trop courte pour se résigner à lire des livres mal écrits et coucher avec des femmes qu’on n’aime pas.